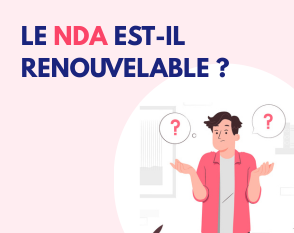Audit de surveillance Qualiopi : l’essentiel pour bien l’aborder
L’audit de surveillance Qualiopi marque un temps fort dans le cycle de certification. Placé entre le 14e et le 22e mois après l’audit initial, il n’a pas pour vocation de remettre en cause la certification, mais de s’assurer que les engagements qualité restent bien en place. C’est une sorte de point d’étape qui permet de vérifier la continuité de la démarche, en revenant notamment sur les actions menées depuis le premier audit.
Moins long et parfois à distance, cet audit permet de valider la solidité du système qualité, tout en identifiant d’éventuels ajustements nécessaires. Il ne faut donc pas le négliger, car un manquement peut entraîner des conséquences lourdes, comme la suspension du certificat.
Ce que dit la réglementation “et ce qu’il ne faut pas rater”
L’audit de surveillance est encadré par l’Arrêté du 6 juin 2019. Il est imposé dans une période précise : entre le 14e et le 22e mois suivant la certification initiale. En dehors de ce créneau, l’organisme certificateur ne peut pas valider la démarche, et la certification devient caduque.
L’auditeur vérifie que l’organisme respecte toujours les exigences du Référentiel National Qualité (RNQ). Il revient également sur les non-conformités identifiées lors de l’audit initial, et s’assure que des actions correctives ont bien été mises en œuvre. Cet audit se déroule le plus souvent à distance, sauf cas particuliers (signalements, risques particuliers, multi-sites…).
En clair : c’est un audit réglementaire à part entière. Il permet de confirmer que la démarche qualité reste vivante. S’il est raté (notamment en cas de non-conformité majeure non levée), la certification peut être suspendue voire retirée.
Télécharger gratuitement le tableau au format Excel
Nous vous avons résumé tout le référentiel Qualiopi dans un ficher que vous pouvez utiliser comme bon vous semble !
Surveillance vs Audit initial : quelles différences concrètes ?
Ce deuxième audit présente plusieurs différences fondamentales avec l’audit initial :
- Portée : L’audit de surveillance passe en revue l’ensemble des indicateurs applicables, tout comme l’audit initial. Toutefois, une attention renforcée est portée aux points qui avaient fait l’objet de non-conformités lors de l’audit précédent. Ce n’est que dans le cas des nouveaux entrants que certains indicateurs font l’objet d’un traitement progressif : leur formalisation est vérifiée à l’audit initial, tandis que leur mise en œuvre concrète est examinée lors de la surveillance.
- Durée et modalités : L’audit initial prend souvent une journée entière et se déroule en présentiel. L’audit de surveillance, plus léger, est souvent à distance et dure une demi-journée.
- Finalité : Le premier audit vise à obtenir la certification, tandis que l’audit de surveillance vise à la maintenir. Il s’agit de démontrer que les engagements qualité sont respectés sur le long terme.
- Conséquences : Une non-conformité mineure doit être corrigée dans un délai de six mois maximum. En cas de non-conformité majeure, l’organisme dispose de trois mois pour apporter les éléments correctifs attendus. Si les corrections ne sont pas apportées dans les délais impartis, la certification peut être suspendue, voire retirée. Dans certains cas, un audit complémentaire peut être exigé pour lever les doutes.
En résumé, l’audit de surveillance est un contrôle resserré, mais stratégique : il permet de s’assurer que la dynamique qualité reste active.
Déroulement type : comment se passe l’audit ?
Le processus d’audit suit un déroulé assez balisé. Voici les grandes étapes :
- Planification : Environ 12 mois après l’audit initial, le certificateur prend contact pour fixer une date. Il est vivement conseillé de bien se préparer en amont.
- Préparation en interne : Il est utile de mettre à jour le planning qualité, suivre les indicateurs, et ré-évaluer les preuves (évaluations, conventions, bilans, etc.).
- Audit blanc : Réaliser un audit interne (ou avec un consultant) 2 à 3 mois avant l’échéance permet de corriger les éventuelles lacunes.
- Réunion d’ouverture : Le jour J, l’auditeur présente le programme, les points qui seront vérifiés, et les documents attendus. Il échange avec le référent qualité pour faire le point sur les évolutions depuis le dernier audit.
- Vérification des preuves : L’auditeur consulte un échantillon d’indicateurs, s’attarde sur les preuves concrètes, et interroge le personnel sur les pratiques. Il vérifie notamment la traçabilité, les actions menées, et les documents justificatifs.
- Réunion de clôture : L’auditeur formule ses observations, mentionne les points conformes ou non, et précise les suites éventuelles : corrections à apporter, audit complémentaire, maintien ou suspension.
Tout au long de l’audit, ce ne sont pas les procédures en elles-mêmes qui sont évaluées, mais leur mise en œuvre réelle. C’est là que se joue souvent la différence.
Les pièges à éviter et les points sensibles à surveiller
Plusieurs erreurs reviennent souvent lors des audits de surveillance, notamment :
- Procédures non appliquées : Des documents bien rédigés ne suffisent pas. Il faut pouvoir démontrer leur utilisation effective (émargements, comptes rendus, actions menées…).
- Suivi des non-conformités : Toute NC identifiée lors du premier audit sera revue. Il faut pouvoir en montrer la résolution. Sinon, elle peut basculer en NC majeure.
- Veille réglementaire : L’indicateur 23 est souvent en défaut. Il est essentiel de documenter les sources de veille et les ajustements apportés.
- Amélioration continue : L’indicateur 32 demande des preuves concrètes (plans d’action, mesures d’impact, retours analysés).
- Réclamations : Un processus incomplet ou non documenté peut entraîner une NC. Il faut prouver que chaque réclamation est enregistrée, traitée et suivie.
- Évolutions de l’offre : Tout changement (nouvelle formation, nouveau formateur…) doit être intégré au système qualité, avec les justificatifs à l’appui.
Ces points sont systématiquement revus car ils permettent de vérifier que la démarche qualité est bien active, et non simplement formelle.
Les indicateurs qui comptent vraiment
L’audit de surveillance ne passe pas tout au crible, mais se concentre sur certains indicateurs jugés cruciaux :
- Les indicateurs communs à tous : 1, 2, 11, 12, 22, 24, 25, 26, 32
- Les indicateurs spécifiques à votre activité (formation, VAE, apprentissage, etc.)
- Les indicateurs ayant donné lieu à des non-conformités précédemment
Parmi les incontournables, l’indicateur 12 (amélioration continue) et l’indicateur 22 (veille) sont systématiquement examinés. L’indicateur 24 (satisfaction) est également central, tout comme l’indicateur 32 (respect des obligations légales).
En pratique, l’auditeur procède par échantillonnage. Il sélectionne quelques actions de formation récentes, et vérifie que toutes les preuves attendues sont bien présentes.
Bien se préparer : conseils concrets
Pour réussir l’audit, mieux vaut ne pas attendre la dernière minute. Voici les bonnes pratiques à adopter :
- Organiser la qualité dès le début : Dès la fin de l’audit initial, mettez en place un planning qualité annuel, suivez vos indicateurs, et impliquez vos équipes.
- Documenter systématiquement : Conservez toutes les preuves de vos actions. Un dossier clair, classé par indicateur, facilitera le travail de l’auditeur.
- Suivre les plans d’action : Tenez à jour les actions correctives avec un calendrier, des preuves de réalisation, et une évaluation de leur impact.
- Former les équipes : Le référent qualité, mais aussi les formateurs, doivent être capables d’expliquer leurs démarches.
- Simuler l’audit : Réalisez un audit blanc en amont pour détecter les failles et rassurer vos équipes.
- Utiliser les bons outils : Guides Qualiopi, plateformes de suivi, accompagnement spécialisé… toutes les ressources fiables sont les bienvenues.
Besoin d'un kit Qualiopi avec tous les document pré-remplis ?
Ce qui change et ce qui va évoluer..
Depuis début 2024, la version 9 du RNQ renforce certaines exigences : traçabilité, amélioration continue, mise à jour documentaire. Il faut adapter ses pratiques en conséquence.
Par ailleurs, des évolutions plus larges sont à anticiper : réforme du RNQ, évolutions des indicateurs et des exigences. La veille réglementaire (indicateurs 23, 24, 25) est donc plus stratégique que jamais.
Enfin, l’accompagnement par un expert, qu’il soit interne ou externe, reste une valeur sûre. Il permet de sécuriser la conformité et de gagner en sérénité.
Conclusion : l’audit de surveillance, un rendez-vous à ne pas improviser
L’audit de surveillance n’est pas un simple contrôle de routine. C’est un point d’étape qui met en lumière la capacité d’un organisme à faire vivre son système qualité. Se préparer sérieusement, garder ses preuves à jour, et mobiliser son équipe : voilà les clés d’un passage sans accroc. Dans un contexte en constante évolution, cet audit est aussi l’occasion de renforcer ses pratiques et de sécuriser son avenir en tant qu’acteur de la formation professionnelle.

Fast Certif vous recommande la newsletter Digi-Certif : actus CPF, RS/RNCP, Qualiopi, outils pratiques et alertes utiles — directement dans votre boîte mail.